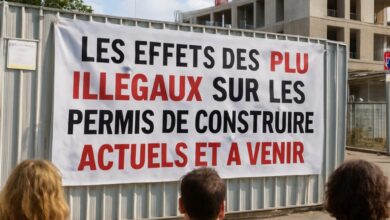Actualités
Le décret du 18 juillet 2025 : l’amiable au centre des litiges.

Le décret du 18 juillet 2025 marque une évolution significative dans le domaine de la justice civile en France, en intégrant des mécanismes de résolution amiable au sein des procédures judiciaires. Cette réforme vise à améliorer l’efficacité des litiges tout en favorisant le dialogue entre les parties.
Un nouveau cadre pour la justice amiable
Le décret du 18 juillet 2025 encadre l’instruction conventionnelle et encourage la coopération procédurale. Il introduit une approche plus collaborative dans le traitement des affaires civiles, permettant ainsi aux parties de s’impliquer davantage dans la gestion de leur litige. Cette évolution répond à un besoin croissant d’une justice plus rapide et moins coûteuse, en phase avec les attentes de la société contemporaine.
Les enjeux de la réforme
Traditionnellement, l’instruction des affaires civiles était sous la responsabilité exclusive du juge de la mise en état, qui déterminait les délais et le calendrier des échanges entre les parties. Cependant, cette méthode a souvent conduit à des délais excessifs, nuisant à la résolution rapide des conflits. Le décret vise à remédier à cette situation en introduisant des options de règlement amiable, telles que :
- Instruction simplifiée
- Convention de mise en état (CPPME)
- Convention de règlement amiable (CPPRA)
Application et impact de la réforme
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux instances en cours depuis le 1er septembre 2025, à l’exception des conventions de mise en état, qui ne concernent que les affaires introduites après cette date. Cette réforme représente une avancée majeure dans la politique nationale de l’amiable, fluidifiant les procédures civiles et permettant une gestion concertée des litiges.
En intégrant des mécanismes de médiation et de conciliation, le décret favorise une justice moins descendante et plus collaborative. Les parties sont désormais responsabilisées, ce qui contribue à une meilleure gestion des conflits. Le juge peut ainsi se concentrer sur son rôle juridictionnel, tandis que les justiciables s’engagent activement dans le processus.
Défis à relever
Malgré ces avancées, la mise en œuvre de cette réforme nécessite un changement culturel parmi les magistrats, les avocats et les justiciables. Tous devront s’adapter aux nouveaux rouages de cette justice « multi-portes » pour en garantir l’efficacité. La réussite de cette transformation dépendra de la capacité des acteurs du droit à s’approprier ces nouvelles pratiques.
Cette réforme constitue une étape importante vers une justice moderne, plus adaptée aux réalités actuelles et aux besoins des citoyens. Elle ouvre la voie à une approche plus humaine et collaborative dans la résolution des litiges, tout en préservant l’autorité judiciaire.