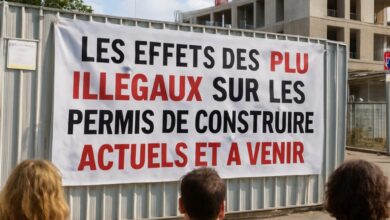Actualités
L’acte de Gouvernement : un principe juridique flexible mais résilient.

Le concept d’acte de Gouvernement est un élément clé du droit administratif français, caractérisé par son immunité juridictionnelle. Cet article explore les implications de cette notion, son évolution historique et son impact sur la légalité des actes administratifs.
L’acte de Gouvernement : définition et principes
L’acte de Gouvernement désigne des décisions prises par le gouvernement qui échappent au contrôle juridictionnel. Cela signifie qu’un justiciable ne peut pas contester ces actes par un recours pour excès de pouvoir ou par une exception d’illégalité. Ce principe repose sur le respect de la hiérarchie des normes, où l’administration doit se conformer aux normes supérieures, comme le stipule la théorie de la pyramide des normes de Hans Kelsen.
Historique et évolution
Historiquement, c’est sous la IIIᵉ et la IVᵉ République que le Conseil d’État a commencé à contrôler la légalité des actes administratifs. Ce contrôle s’est renforcé avec l’introduction du recours pour excès de pouvoir, même en l’absence de texte spécifique. Cependant, pour garantir la continuité de l’action gouvernementale, une certaine liberté d’action est nécessaire, ce qui a conduit à l’émergence des actes de Gouvernement.
Les actes de Gouvernement et la légalité
Les actes de Gouvernement peuvent être considérés comme une altération du principe de légalité. Plusieurs textes législatifs, tels que l’article 16 de la Constitution ou la loi du 3 avril 1955 sur l’état d’urgence, illustrent cette exception. Des arrêts fondateurs du Conseil d’État, comme l’arrêt Lafitte de 1867 et l’arrêt Prince Napoléon de 1875, ont établi que ces actes sont insusceptibles de recours juridictionnel.
Une notion réaffirmée par le Conseil d’État
Malgré une tendance à réduire l’importance des actes de Gouvernement, ceux-ci continuent d’échapper au contrôle de légalité, bien que leur champ d’application soit désormais limité. Ils concernent principalement les relations entre institutions et les relations internationales. Par exemple, un arrêt récent a confirmé qu’une décision gouvernementale d’interdiction d’exposition pour des entreprises israéliennes relevait de la conduite des relations internationales de la France.
En revanche, la jurisprudence a introduit la notion d’acte détachable, permettant à certains actes, comme les décrets d’extradition ou les mesures d’embargo, d’être soumis au contrôle du juge administratif. Cela montre une volonté d’équilibrer la souveraineté de l’État avec le respect des droits des individus.
Le Conseil d’État reste attaché à la notion d’acte de Gouvernement, même face aux défis posés par des requérants. Cette notion continue d’être mise à l’épreuve, notamment dans le cadre des relations internationales, mais elle demeure un pilier du droit administratif français.