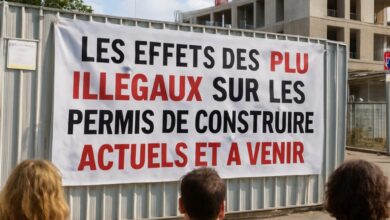Actualités
CGV et CGA : une analyse d’un conflit perpétuel sur le consentement.

Dans le domaine commercial, les conditions générales de vente (CGV) et d’achat (CGA) illustrent une tension permanente entre les intérêts des vendeurs et des acheteurs. Cet article explore les enjeux liés au consentement dans les relations contractuelles, en mettant en lumière les mécanismes juridiques qui régissent cette dynamique complexe.
Les enjeux des CGV et CGA
Les CGV et CGA représentent un dialogue entre deux logiques juridiques opposées. D’une part, le vendeur cherche à établir des conditions strictes pour protéger son offre, tandis que l’acheteur souhaite garantir ses droits et sa sécurité. Cette interaction crée un déséquilibre, où chaque partie tente de réguler la relation selon sa propre vision. L’article 1102 du Code civil consacre la liberté contractuelle, mais cette liberté peut parfois masquer un désordre sous-jacent.
Le consentement actif
Le consentement actif se manifeste par une volonté clairement exprimée, souvent à travers des clauses contractuelles. Par exemple, la clause de hiérarchie permet de déterminer quelle condition prévaut en cas de conflit. La Cour d’appel de Paris a illustré ce principe dans un arrêt du 21 mai 2025, où l’acheteur a été lié par ses propres CGA annexées à ses bons de commande, signifiant que la clarté des clauses contractuelles peut produire des effets juridiques significatifs.
Des mécanismes comme la « Last Shot Rule » et la « First Shot Rule » montrent comment le comportement des parties peut influencer le consentement. En France, l’article 1119 du Code civil stipule que les clauses incompatibles sont sans effet, cherchant ainsi à préserver la cohérence des relations contractuelles.
Le consentement passif
À l’opposé, le consentement passif se déduit du comportement des parties. La Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 23 janvier 2025, a reconnu que l’absence d’objection face à des CGV transmises à chaque commande pouvait valoir acceptation tacite. Ce phénomène souligne l’importance des habitudes commerciales et des pratiques établies dans la détermination du consentement.
Le Tribunal judiciaire de Strasbourg a également confirmé que le silence, lorsqu’il suit une information claire, peut être interprété comme un acte juridique. Toutefois, cette approche nécessite une vigilance accrue pour éviter de confondre la volonté avec l’habitude.
Conclusion
La relation entre CGV et CGA n’est pas figée, mais reflète une tension constante entre l’acte juridique et le fait juridique. Dans ce contexte, le consentement, qu’il soit actif ou passif, joue un rôle crucial. La capacité à transformer une volonté en acte, même par des moyens implicites, devient essentielle pour naviguer dans le paysage complexe des relations commerciales.