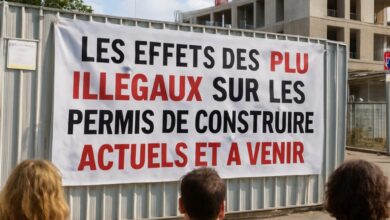Actualités
Quels sont les droits de l’Océan ?

Le droit de la mer est un domaine en pleine évolution, marqué par des initiatives internationales visant à renforcer la protection des océans. Cet article examine les enjeux liés à la gouvernance maritime, les avancées récentes et les critiques qui entourent la Déclaration de Nice, adoptée lors de la Conférence des Nations Unies sur l’Océan en 2025.
Une préoccupation inscrite dans l’ordre juridique
Le droit de la mer : de la coutume internationale à la codification
Le droit de la mer a connu un développement complexe, avec des étapes clés telles que la première conférence de codification à La Haye en 1930 et la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer en 1973. Ces événements ont permis d’établir un cadre juridique pour la protection des espaces marins, bien que la mise en œuvre reste un défi. Selon Maître Nolwenn Chaigneau, des règles coutumières, comme le droit d’accès au port pour les navires en détresse, illustrent cette évolution.
Une volonté citoyenne d’aller plus loin
La mobilisation citoyenne pour la protection des océans s’est intensifiée, comme en témoigne l’appel lancé par Marine Calmet et François Sarano en mars 2025. Leur initiative vise à reconnaître les droits de l’Océan, en lien avec les engagements pris lors de l’accord mondial signé au Canada en décembre 2022. Cette dynamique souligne l’importance de la participation des citoyens dans la gouvernance maritime.
La Déclaration de Nice : continuité ou rupture
Un texte coupable de greenwashing
Malgré les avancées, la Déclaration de Nice a été critiquée par des ONG comme Greenpeace, qui la qualifient de « coquille vide ». Les critiques portent sur l’absence d’engagements contraignants pour limiter des pratiques destructrices telles que le chalutage de fond. Cette situation soulève des questions sur l’efficacité des mesures proposées.
Des initiatives vers l’objectif final de reconnaissance de la personnalité juridique des océans
La Déclaration de Nice représente une étape symbolique dans la construction d’un cadre juridique plus respectueux des océans. Des avancées notables ont été enregistrées, avec plus de 800 engagements volontaires pris par des États et des acteurs de la société civile. Par exemple, l’Union européenne a annoncé un investissement d’un milliard d’euros pour la conservation marine.
En somme, bien que des progrès aient été réalisés, la mise en œuvre des engagements reste entravée par des obstacles politiques et économiques. La nécessité d’un cadre juridique solide pour la protection des océans est plus que jamais d’actualité, et les initiatives citoyennes jouent un rôle crucial dans cette dynamique. La reconnaissance des droits de l’Océan pourrait constituer une avancée majeure dans la gouvernance maritime internationale.