Actualités
La responsabilité des créations issues de l’Intelligence Artificielle.
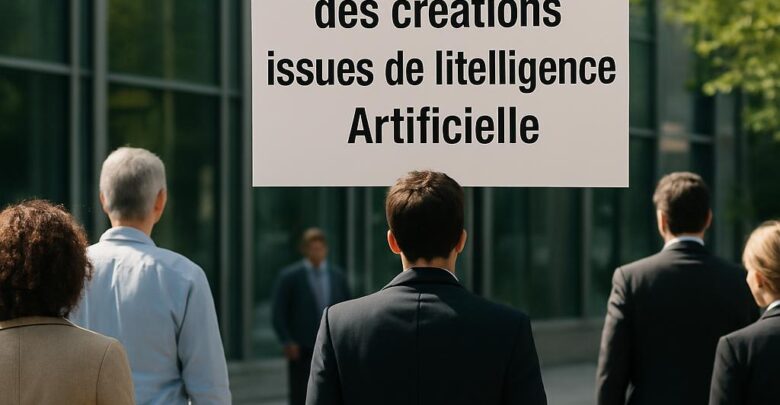
Cet article aborde les enjeux juridiques liés à la paternité des œuvres générées par l’intelligence artificielle (IA). Il explore les différentes perspectives sur la reconnaissance des droits d’auteur, en examinant les rôles de l’IA, du concepteur et de l’utilisateur dans le processus créatif.
La paternité des œuvres générées par l’Intelligence Artificielle
L’intelligence artificielle (IA) est définie comme un processus logique et automatisé capable d’exécuter des tâches spécifiques. Depuis son apparition lors de la conférence de Dartmouth en 1956, l’IA a pris une place prépondérante dans divers domaines, y compris l’art. Des outils tels que ChatGPT, Midjourney et AIVA sont devenus des partenaires de création. Cependant, cette intégration soulève des questions cruciales sur la propriété littéraire et artistique : qui détient les droits sur une œuvre créée par une machine ?
I. L’ambiguïté de la détermination de l’auteur de l’œuvre générée
La question de l’auteur d’une œuvre générée par l’IA est complexe en raison des multiples acteurs impliqués. Trois approches principales émergent :
- A. L’IA comme autrice : Cette perspective suggère que l’IA pourrait être reconnue comme l’auteur des œuvres qu’elle crée. Toutefois, cela contredit les principes du droit d’auteur, qui stipulent que seul un être humain peut revendiquer cette qualité.
- B. Le concepteur comme auteur : Cette approche attribue la paternité de l’œuvre au développeur de l’IA, en raison de son investissement intellectuel et financier. Cependant, cela pose la question de la confusion entre le concepteur et les œuvres générées.
- C. L’utilisateur comme auteur : Cette théorie considère que l’utilisateur, qui interagit avec l’IA, est l’auteur. L’utilisateur initie le processus créatif, mais cette reconnaissance dépend de l’ampleur de son intervention.
II. Les perspectives d’attribution de la titularité des droits sur l’œuvre générée
La titularité des droits sur les œuvres générées par l’IA reste incertaine. Plusieurs propositions ont été avancées :
- A. Reconnaissance de l’utilisateur comme titulaire des droits : Cette option est souvent envisagée, car l’utilisateur déclenche le processus créatif et en contrôle l’orientation.
- B. Création d’un régime sui generis : Un régime spécifique pourrait être établi pour protéger les œuvres générées par l’IA, permettant aux créateurs de bénéficier d’un retour sur investissement.
- C. Domaine public par défaut : Une autre proposition consiste à placer les œuvres générées par l’IA dans le domaine public, permettant à tous de les utiliser sans droits réservés.
Les débats autour de la paternité des œuvres générées par l’IA soulignent la nécessité d’une adaptation du droit de la propriété intellectuelle face aux innovations technologiques. Une concertation entre les différents acteurs, juristes et législateurs sera essentielle pour établir un cadre juridique efficace et équilibré.





